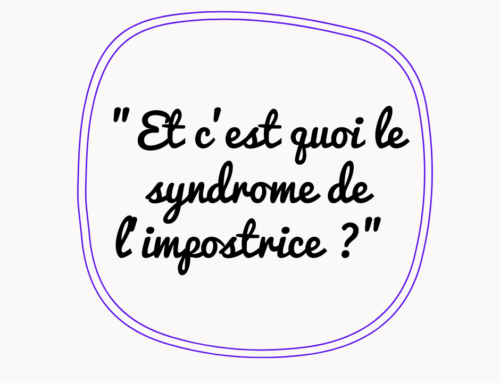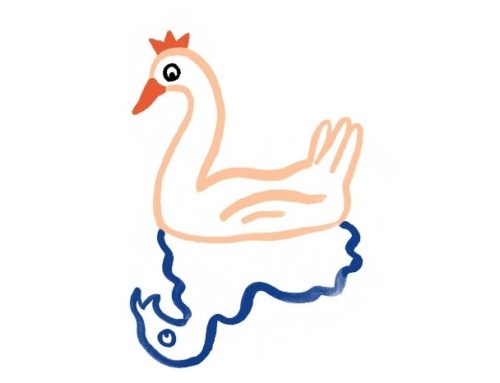féminicides : crime passionnel le mot est faux
Feminicide oui, crime passionnel, le mot est faux ! Jusqu’en 2019 nous utilisions collectivement les termes de crime passionnel, de crime d’amour ou d’homicide. On l’utilisait notamment dans les médias, lorsqu’un homme tuait sa compagne ou son ex. La réalité de ce que sont les féminicides n’était donc pas du tout prise en compte. Ce terme existe enfin et nous l’utilisons de plus en plus régulièrement. Féminicides donc, ne dites plus crime passionnel !
C’est parce qu’il est vital de montrer la réalité jusque dans sa lumière la plus crue, que Christophe Pluchon[1] m’a proposé il y a quelques semaines une émission radiophonique au sujet du féminicide. Le 22 décembre dernier, nous enregistrions donc une émission pour l’antenne finistérienne de la radio RCF.
Je dis « nous » car j’étais accompagnée de Patricia Le Fell. Cette femme engagée avait une soeur, Christelle, qui a été féminicidée en 2013. Patricia a créé l’association Chris à vif pour soutenir des familles endeuillées.
Christophe m’a contactée car, depuis l’interview qu’il avait faite à propos d’Egaluce, mon entreprise, nous nous suivons sur les réseaux sociaux notamment et il connait mon engagement. Je travaille désormais notamment via le prisme de l’empouvoirement féminin, c’est-à-dire que j’accompagne des femmes à oser plus, parler, exister, dans le champ professionnel, associatif et privé.

féminicides : crime passionnel le mot est faux
Cela suppose parfois d’abord de reconnaitre les situations de victimation qu’elles ont subi (comme des violences conjugales ou des tentatives de féminicides, mais aussi des violences sexuelles et sexistes au travail). Puis de pouvoir les accompagner à s’inventer et se réinventer en tant que femmes, pour exister dans l’espace public, politique, général.
Mais pourquoi parler de féminicide plutôt que de meurtre, puisque ce terme existe et recouvre les homicides ?
C’est la première question à laquelle nous avons tenu à répondre afin de poser le cadre de l’intervention.
Le terme de féminicide ne fait pas doublon, il marque une spécificité : il s’agit du meurtre d’une femme par un conjoint ou un ex-conjoint dans le cadre, généralement, d’un continuum de violences conjugales et ce, parce qu’elle est une femme.
L’homicide est trop vague. Les autres expressions que nous avons tant vues et entendues sont une insulte aux femmes tuées et à leurs proches -dont nous reparlerons après.
Non, il ne s’agit pas de « coup de folie », puisque cela s’inscrit dans un schéma d’emprise.
Non, il ne s’agit pas plus d’un « meurtre de l’amour » que d’un « crime passionnel » puisqu’on ne tue pas par amour. Il s’agit de crimes de possession, d’emprise, et de violence.
Et ces crimes ne sont possibles que sous un régime particulier, celui du patriarcat.
Oui, le patriarcat c’est le système dans lequel nous vivons dans le monde et en France. C’est ce système qui concourt à donner à penser que les hommes dominent les femmes et que le masculin l’emporterait sur le féminin. Et cela, pas seulement dans notre écriture mais dans tout notre quotidien. C’est ce système qui va concourir à la prépondérance des violences conjugales des hommes sur des femmes. Le symptôme le plus fatal, ce sont les féminicides, qui s’exerçaient jusqu’à il y a encore peu de temps, dans une quasi-impunité.
Féminicides, ne dites plus crime passionnel !
L’éducation au cœur des enjeux du futur
Nous avons à traiter les situations actuelles, chez les adultes, en même temps que nous avons à préparer le futur. Or, nous disposons désormais d’outils à dispositions (fiches, livres, podcasts, intervenant-es formé-es, professionnel-les et engagé-es à la fois, militant-es). Mais l’éducation de façon générale reste très genrée, aussi bien dans les familles qu’à l’école. Des stéréotypes de genre vont infuser en nos enfants, depuis leur naissance. Il y a donc une transmission quotidienne d’idées selon lesquelles le masculin l’emporte sur le féminin et ce pas seulement en orthographe et en grammaire !
Le fait de genrer l’éducation, notre vocabulaire, va ensuite s’instiller dans tous les pans de nos vies, des plus visibles aux plus intimes. Cela est notamment visible dans notre vocabulaire professionnel.
C’est d’ailleurs pourquoi, avec Ninja Himbert, qui est designeuse, nous avons développé un calendrier de l’Avent de la féminisation des métiers. Chaque jour en décembre nous avons proposé un nom de métier, allant de la garagiste à la médecine en passant par l’exploratrice et la pêcheuse[3].
Ce que cette initiative montre, c’est qu’il est possible de sortir d’un système patriarcal, de transmettre à nos enfants des imagos qui sortent des stéréotypes de genre. Mais cela n’est possible qu’avec la volonté de toutes et de tous et la mise en place, au quotidien de la méthode des petits pas, des petites actions.
Le rôle des médias
Les médias peuvent transmettre de façon quotidienne et facile, via la radio, la télévision et la presse écrite, des possibles.
Avant tout, pour faire entendre aux femmes qui subissent ces violences que celles-ci ne sont pas normales, qu’elles ont le droit de partir, que la violence dans la sphère intime n’est pas une fatalité, que la réalité des violences conjugales, c’est qu’elles peuvent conduire au féminicide. Et que pour ce faire il existe pour elles des structures et des engagé-es. On peut s’en sortir pour soi, ses enfants, avec ses enfants.
Une diffusion large permet aussi de faire sortir les agresseurs du silence et de la toute-puissance que ce silence permet.
Ce qui est tu n’existe pas
Or, ce que nous voulons, c’est justement que chacune et chacun sache à quoi il ou elle s’expose dans de telles situations.
Dans ce cadre, lorsque les médias parlent de féminicides, ils concourent à transmettre une idée de justice, de loi, d’égalité, à la fois de respect pour les victimes (leurs proches) et d’engagement en faveur de la fin des violences patriarcales.
Les médias doivent prendre leur part de responsabilité dans cette chaine des droits humains et de la cessation des violences. Chers médias : dites Féminicides, ne dites plus crime passionnel !
Une chaine de compétences et de responsabilités : le témoignage de Patricia Le Fell[4]
« Christelle Le Fell, ma sœur, 34 ans, a été assassinée en mai 2013 par son conjoint, d’un coup de fusil, en présence de ses deux enfants. Elle avait déjà subi des violences conjugales avec son précédent conjoint, père des enfants, et avait réussi à partir, avec l’aide de travailleurs sociaux et de mon soutien.
Un an et demi après elle est tombée sur un homme encore plus violent. C’était des gestes quotidiens, des mots, des injures, des coups. Il mettait souvent ma sœur et mes neveux en joue avec le fusil pour les faire sortir de l’appartement.
Ma sœur ne nous en a pas parlé au début. Elle avait peur, et surtout, elle tombait de nouveau sur un homme violent et pour elle c’était une honte inimaginable. Elle n’en a parlé que 5 mois avant sa mort, elle a alors osé poser des mots sur son calvaire, m’a dit qu’elle vivait un calvaire. J’ai voulu l’aider et c’est compliqué d’aider une femme victime de violences conjugales : elle ne savait pas où aller. Elle avait peur qu’on ne la croit pas, d’autant qu’elle vivait une deuxième fois la même chose.
En mai 2013, j’ai reçu un appel de ma mère, à 23h30 on venait d’assassiner ma sœur. J’ai tout de suite compris que c’était lui qui avait commis cet acte. Pendant tout le trajet pour me rendre sur les lieux je ne voulais pas y croire. C’est en voyant la police, les pompiers, que j’ai réalisé ce qui se passait.
J’ai été prise en charge par une équipe policière et les premiers mots qui m’ont été dits c’était que ma sœur n’avait pas souffert, qu’elle était morte sur le coup. Je n’ai pas compris ce qu’on me disait. Je suis montée au premier étage retrouver mes neveux. Ils étaient couverts de sang, ma mère était là. On nous a demandé de ne pas pleurer et de nous taire, pour ne pas choquer les enfants. C’est plutôt ironique, ils venaient de voir leur mère se faire tirer dessus !
A ce jour, ma mère n’a toujours pas réussi à pleurer. On nous a réduites au silence ce soir de mai. Depuis je me suis dit que je ne me tairai plus.
S’installe alors une machine judiciaire qui nous tombe dessus comme une bombe.
On n’est pas préparés à ça nous, les familles.
D’abord, quand on nous l’a annoncé, c’était en pleine nuit : pas de cellule psychologique. Il y a un temps d’annonce, puis vous rentrez chez vous avec deux enfants traumatisés. Il n’ a pas de réponse à nos questions, ni à celles des enfants. Oui, elle est morte, c’est tout.
Le lendemain, on cherche des réponses, on apprend ce qui s’est passé dans les médias. A l’époque, dans le Télégramme. Le reste de la famille ne savait pas, on n’a pas eu le temps de le dire, ils découvrent tout par la presse.
On met le nom de la victime dans les journaux mais jamais l’auteur.
On y écrit que c’est un homme bien qui, du fait d’un coup de folie, a tiré sur sa compagne. J’ai appelé le journaliste à l’époque pour remettre les choses à plat ! Désolée, non, un homme bien ne tue pas, ne violente pas sa femme !
Impossible d’avoir des réponses de la part du commissariat, l’enquête est en cours. Personne ne peut voir le corps, il faut attendre une semaine pour voir le corps. Une autopsie est faite. On n’a aucune réponse à apporter aux enfants, personne ne sait rien. A aucun moment nous ne rencontrons de, le soir on nous donne juste une carte en nous disant qu’on peut se présenter à un endroit.
La famille doit se débrouiller. Heureusement, j’étais dans le milieu hospitaliser à l’époque donc j’ai trouvé où aller frapper. Il n’y avait aucune structure qui accompagne les familles, en tout cas je n’en connaissais aucune.
Il faut aussi penser que les enfants n’ont plus rien : il y a des scellés sur la porte de l’appartement. Les enfants n’ont plus de vêtements, de jeux, d’affaires, rien ! On se débrouille pour tout.
Suite à ce qui est arrivé à ma sœur, beaucoup de femmes dans mon entourage pro ou par les réseaux sociaux m’ont demandé de l’aide.
Elles me disent qu’elles ne veulent pas finir comme ma sœur.
Je me suis alors aperçue qu’il y a beaucoup de femmes comme ma sœur, qui vivent des violences conjugales ; beaucoup disent qu’elles ont peur et honte.
Je me suis dit que je ne pouvais pas rester à ne rien faire.
Ces femmes, c’est comme ma sœur. Je me suis donc engagée auprès d’elles. Au travail dans un premier temps, j’ai accompagné des collègues à s’en sortir.
Elles ressentent de la honte de se faire frapper, insulter, et puis aussi d’en parler.
La honte, un mot qui revient sans cesse… chez les victimes :
Les termes « honte » et « culpabilité » reviennent très régulièrement dans les mots des victimes. C’est très difficile pour des victimes de se reconnaitre comme telles.
Ce sont souvent des violences qu’elles n’ont pas identifiées tout de suite comme telles, qu’elles ont « laissé passer ». Un cercle de violence s’installe au moyen d’un climat de terreur. Une fois qu’on est dans ce cercle c’est très difficile d’en sortir parce que ce n’est pas une violence unique, mais un cadre quotidien, organisé. »
L’inquiétude de ne pas être crue est telle que les mouvements féministes s’en sont saisis. A toute victime on dit d’abord « je te crois ».
Patricia parlait de ces femmes « comme sa sœur », et le principe de sororité est très important. Pouvoir entre nous se soutenir. On fait partie d’un système au sein duquel nous sommes toutes oppressées par le patriarcat et les hommes. Du coup, se soutenir entre nous, par la sororité, c’est essentiel et la clé pour s’en sortir ».
Des outils :
Nous disposons actuellement en France de plusieurs outils. Il s’agirait de les centraliser, et de former les personnes à s’en saisir et à savoir les utiliser. Il reste beaucoup de travail pour sensibiliser celles et ceux qui sont aux premières loges de la prise en compte des victimes, au principe de l’emprise, des violences conjugales et au terme de féminicide.
Patricia fait partie de l’AFVF, qui existe en France entière. Créée en octobre 2020, elle accompagne et soutient les familles de victimes de violences conjugales et de féminicides.
On a aussi beaucoup parlé du Grenelle en 2019. L’idée initiale est de prendre en compte une réalité : le féminicide n’est pas un fait divers, c’est un fait social.
On rappellera à ce titre qu’en 2019 il y a eu 152 meurtres conjugaux de femmes.
Ce que le Grenelle a promis, est très intéressant, notamment par exemple l’engagement que le numéro 3919 soit fonctionnel 24h/24. Le 3919 c’est 2000 appels de femmes victimes par semaine, et jusqu’à 7000 pendant le confinement !
Le gouvernement a donc décidé d’ouvrir ce dispositif à un marché public, et donc à une mise en concurrence des structures qui pourraient mettre en place ce service en 24h/24. Or, ce numéro a été mis en place dès 1992 par une fédération de 73 associations. Celle-ci qui craint désormais de se voir dépossédée du travail effectué, de ses engagements et de son professionnalisme.
Cet exemple montre bien que ce qui est proposé aux termes du Grenelle peut être de bon aloi. Mais seulement si cela se met en place de façon concrète dans la société. Et si cela ne met pas à mal le travail de terrain déjà réalisé.
Cela montre aussi qu’en matière d’avancées sur ce sujet, la volonté à tous les niveaux de décision est capitale. Nous pouvons en cela comparer notre pays à l’Espagne, pays proche, avec une population inférieure en nombre de 30% à la France. Pourtant, dès 2004, l’Espagne a édicté une loi de politique globale à propos des violences de genre et des féminicides. C’était il y a quasiment 20ans, c’est dire à quel point en France, dans le pays dit des Droits de l’Homme, nous restons loin d’un pays des Droits Humains !
Cette loi de 2004 offre une perspective féministe, avec une réflexion globale sur le système patriarcal qui conduit à des symptômes spécifiques comme les violences conjugales et féminicides.
Le Pacte d’Etat qui lui fait suite en 2017 propose 290 mesures qui concernent tous les protagonistes : responsabilité de l’Etat, des médias, des organes de l’Etat (travail social, monde judiciaire, monde policier et de l’enquête), des acteur-rices de terrains ; les victimes, les auteurs, et les mineurs.
Un budget d’un milliard d’euros est prévu en 2018. Ce chiffre aujourd’hui porté et demandé par les associations en France ne sort donc pas de nulle part, il sort de la réalité prise en compte par un pays voisin, l’Espagne. Ce budget prévoit d’ailleurs aussi la prise en charge des mineurs, qui sont co-victimes dans les situations de violences conjugales et de féminicides. Oui, de féminicides : Féminicides, ne dites plus crime passionnel !
Des mineurs co-victimes
En 2018, 21 enfants sont morts avec leur mère dans un cadre de féminicides, ou bien dans le cadre de violences conjugales et du continuum de violences conjugales.
Le féminicide n’est pas un acte unique et isolé d’un homme qui « pète les plombs à cause de sa femme ». C’est la réponse ultime à un système de violences qui préexistent, au sein duquel les enfants sont eux-mêmes des co-victimes. Soit elles sont victimes de la violence conjugale en tant que témoins, soit dans la moitié de ces situations environ, elles sont aussi victimes de violences et de sévices sexuels.
En France en 2019 on comptabilise 29 enfants témoins de féminicides. Le centre Hubertine Auclert, comptabilise 143 000 enfants vivant en France en 2020 dans un foyer dans lequel une femme a déclaré des formes de violences physiques et/ou sexuelles et/ou (mais j’ai envie de dire toujours ET) psychologiques à leur encontre. Il y a donc toutes les familles pour lesquelles on ne le sait pas.
Près de la moitié de ces mineurs ont moins de 6 ans.
Quand on s’engage sur la question des droits des femmes, des droits humains, de l’égalité en faveur des femmes et des hommes, et quand on s’engage comme on le fait toutes les trois autour des situations de violences conjugales et de féminicides, en fait on prépare l’avenir.
Parce qu’on accompagne aussi des enfants, des familles et les enfants représentent l’avenir de notre nation.
Si dès le début de leur vie, ils se trouvent dans un contexte familial de violences, leur cerveau va se placer en mode « survie ». Toute femme qui subit actuellement des violences conjugales court le risque d’être tuée dans son quotidien. Et tous ceux qui font partie de cette cellule familiale et qui sont les témoins de cette violence (enfants) sont forcément co-victimes parce qu’eux aussi se construisent en mode survie.
Comment peut-on, quand on a vécu les 18 premières années de sa vie, dans un contexte de violence,
être ensuite un adulte qui va bien ?
Les violences conjugales peuvent conduire à un féminicide mais ne sont pas une fatalité que nous pouvons accepter pour nous-mêmes ou pour nos proches. On peut être accompagnée et s’en sortir !
Cela suppose que les victimes puissent parler, être entendues et crues, puis prises en charge. Mais c’est aussi un engagement que nous devons toutes et tous prendre, aussi bien dans le cadre privé que professionnel. Et c’est l’engagement que nous prenons chez Egaluce : contactez-nous